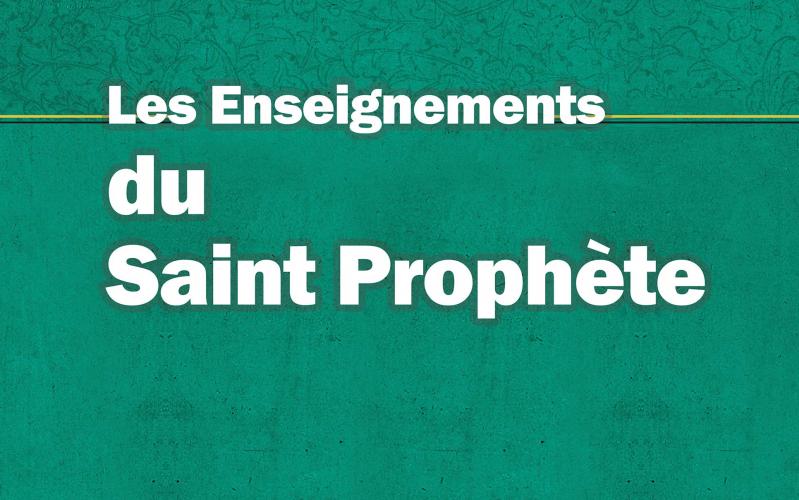Zahra Shafei, chercheuse en culture
C’est en 2019 que Serena Williams, championne mondiale de tennis, est apparue dans une campagne publicitaire de Nike sous le slogan « Dream Crazier » (rêve encore plus fou) pour transmettre le message de soutien de cette marque mondiale aux athlètes féminines qui cherchent à briser les barrières et défier les attentes. La même année, la championne américaine d’athlétisme Allyson Felix révélait dans une interview les conditions discriminatoires de son contrat avec l’entreprise : « J’ai demandé à Nike de garantir contractuellement que je ne serais pas pénalisée si je ne performais pas au mieux de mes capacités dans les mois entourant mon accouchement. » La réponse de l’entreprise à cette athlète qui ne voulait que « rêver encore plus fou » fut : « Connais ta place et cours, c’est tout ! » [1]
Avidité des entreprises et le marketing féministe : émancipation ou consumérisme ?
Le féminisme, salué comme un mouvement militant pour les droits des femmes et l’égalité des sexes, s’est toujours revendiqué comme agissant pour l’élévation du statut des femmes et leur défense contre le système capitaliste d’exploitation. Pourtant, les slogans des activistes féministes contre « l’oppression économique » et « la cupidité des entreprises » se sont transformés en actions au service total de la culture consumériste.
L’usage de termes comme autonomisation des femmes et défense de l’égalité des sexes est récemment devenu une stratégie marketing fiable pour les entreprises. Presque toutes les grandes marques mondiales ciblent les femmes dans leurs campagnes publicitaires, emploient des slogans conçus pour les filles et développent une publicité ciblée en ligne autour de ces thèmes. Cela s’explique par le fait révélé par des études que 86 % des femmes utilisent les réseaux sociaux pour des recommandations d’achat, [2] des évaluations ou des conseils, et de nombreuses recherches ont également montré que les consommateurs préfèrent acheter auprès d’entreprises qui évoquent des enjeux sociaux dans leurs publicités. [3]
Par exemple, en 2004, Dove a lancé la campagne publicitaire Real Beauty, qui critiquait les standards de beauté eurocentriques, affirmant que la beauté existe sous toutes les couleurs, tailles et traits. La campagne soutenait que les femmes ne devaient pas perdre confiance à cause de normes rigides qui les objectivent. Résultat : cette campagne — encore saluée comme l’une des plus réussies par les firmes publicitaires — a permis à Dove de devenir la marque de savon la plus populaire aux États-Unis, de prendre la tête des ventes d’Unilever (la maison-mère de Dove), et de faire passer son chiffre d’affaires de 2,4 milliards $ en 2004 à 4 milliards $ en 2014 grâce à la ladite campagne. [4]
En parallèle, Unilever, tout en se positionnant publiquement contre les standards eurocentriques de beauté, continue d’utiliser des méthodes traditionnelles de sexualisation des femmes dans les publicités de ses autres marques. De plus, dans des pays asiatiques où la peau foncée est plus répandue chez les femmes, l’entreprise commercialise des crèmes éclaircissantes, promouvant ainsi des normes de beauté proches des populations caucasiennes.
Après tout, le capitalisme continue de tirer profit du manque de confiance en soi des femmes. Peu importe ce que disent les publicités de Dove sur la beauté réelle, le système reste inchangé. L’industrie des soins personnels, désormais un marché mondial de 600 milliards de dollars, présente les dépenses en produits de beauté comme une forme d’activisme. L’Oréal, avec son slogan « Parce que vous le valez bien », lie la valeur personnelle des femmes au consumérisme.
Les stratégies des entreprises pour exploiter le temps passé en ligne par les femmes à des fins publicitaires ont aussi donné aux influenceuses un rôle central dans ce système. Les influenceuses attirent leur public avec du contenu motivant, créant un sentiment de proximité avec leurs abonnés, et les plongent dans un climat intime. En même temps, en affichant une apparence conforme aux idéaux de beauté des annonceurs et en exposant un style de vie sans défaut, elles créent de l’insécurité chez leur audience — pour ensuite les convaincre qu’elles ont besoin d’acheter toujours plus. Les statistiques montrent que 69 % des consommateurs font confiance aux recommandations des influenceurs qu’ils suivent. [5]
À ce stade, ce qui reste des actions stéréotypées et des slogans inefficaces des activistes féministes, c’est l’achat d’une illusion. Acheter un t-shirt avec un slogan féministe imprimé dessus — sans doute cousu par un enfant mal payé dans un atelier d’Asie — ou acheter un produit cosmétique estampillé féministe, ou encore dépenser pour cette marque ou cette autre qui prétendent soutenir les droits des femmes et l’égalité dans leurs pubs, définit l’état actuel du militantisme féministe. Ainsi, dans un paradoxe flagrant, ces entreprises, tout en utilisant des slogans séduisants sur l’autonomisation des femmes et en boostant leur confiance — en leur disant « Tu es suffisante » — leur inculquent en même temps cette idée : pour vraiment se sentir mieux, pour avoir confiance en soi, « peu importe ce que tu achètes, ce ne sera jamais suffisant ». Par conséquent, les femmes qui n’ont pas de pouvoir d’achat sont marginalisées, exclues des messages attirants promus par ces marques.
Derrière les panneaux publicitaires brillants affichant des images de femmes riches et puissantes — du moins selon les récits féministes et capitalistes — se cache une réalité d’exploitation et d’abus. Presque toutes ces entreprises glamour, avec leurs publicités tape-à-l'œil et slogans creux, ont délocalisé leur production vers des pays asiatiques comme l’Indonésie, le Bangladesh ou le Vietnam. Dans ces pays où la réglementation et la surveillance sont faibles, des conditions de travail dangereuses, du travail forcé et du travail des enfants sont monnaie courante. De nombreuses marques bien connues dans le sport, la mode et la beauté sont liées à des usines et des ateliers fonctionnant dans ces conditions d’exploitation. Face à cette misère, la publicité féministe sert de masque, captivant les consommateurs par des slogans, leur faisant croire que leurs achats excessifs font partie d’un combat civique contre l’inégalité des sexes, et leur procurant un sentiment d’engagement dans une consommation matérialiste.
Comme l’a déclaré le Guide suprême de la Révolution lors d’une rencontre avec divers groupes de femmes à l’automne 2024, le véritable objectif des mouvements féministes a été d’exploiter la présence et la participation des femmes en tant que main-d’œuvre bon marché, au service des usines et au profit du système capitaliste — le tout sous le couvert humanitaire de la « liberté des femmes et de l’indépendance financière ». Là encore, derrière les slogans publicitaires mensongers des entreprises et des marques prétendant défendre les droits des femmes, se cachent des mains sinistres qui cherchent à transformer les femmes en consommatrices insatiables, tirant leur identité et estime d’elles-mêmes de l’achat de produits auprès de firmes milliardaires.
Références :
[1] https://www.nytimes.com/2019/05/22/opinion/allyson-felix-pregnancy-nike.html
[2] https://digitalmarketinginstitute.com/blog/20-influencer-marketing-statistics-that-will-surprise-you
[4] Allen, Emma. “Jess Weiner and the Dove Real Beauty Campaign: Selling Feminism for Profit or Social Change?” In Women Leading Change: Case Studies on Women, Gender, and Feminism, 6.1 (2022): 18–37.
[5] https://thefrankagency.com/blog/influencer-marketing-statistics
(Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteure et ne reflètent pas nécessairement celles de Khamenei.ir.)