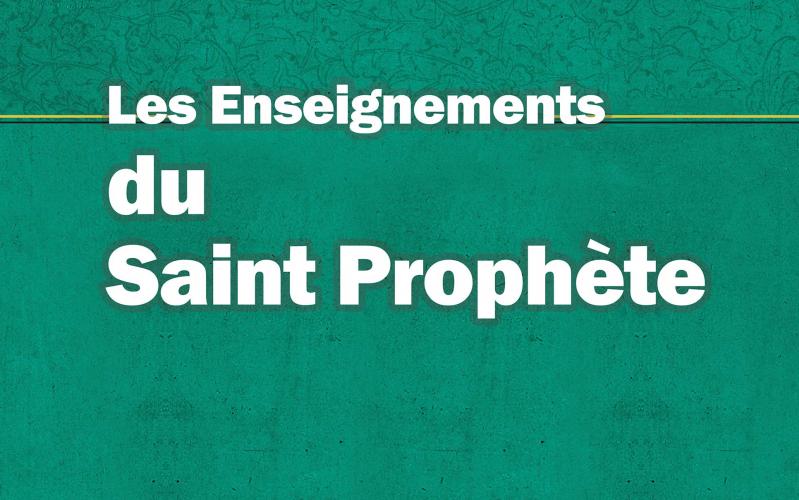Le cessez-le-feu était bien plus qu’un simple accord ; c’était le moment où la Résistance palestinienne a transformé deux années de guerre et de siège incessants en une victoire politique et stratégique décisive.
L’échange massif de prisonniers entre la Résistance palestinienne et le régime sioniste, dans le cadre de l’accord de Charm el-Cheikh, marque un tournant dans la guerre des deux dernières années ; un événement qui a mis fin à deux ans de guerre d’usure à Gaza, tout en portant un message politique et stratégique profond sur le nouvel équilibre des forces qui émerge dans la région.
En apparence, l’accord de Charm el-Cheikh, négocié avec la médiation des États-Unis et de plusieurs gouvernements arabes, visait à mettre fin aux hostilités. Mais en réalité, il est devenu une échelle permettant à Netanyahou de sortir de l’impasse créée par deux années de guerre infructueuse : une guerre qui n’a ni détruit le Hamas, ni permis de récupérer les captifs israéliens par la force, ni rendu à Tel-Aviv le contrôle total de la bande de Gaza.
Donald Trump, à travers son « plan de paix », a tenté d’obtenir par la diplomatie ce qu’Israël n’avait pu conquérir sur le champ de bataille. Pourtant, le résultat final a reflété avant tout l’échec de la logique militaire israélienne et la victoire de la résistance palestinienne.
Tout au long de ces deux années de siège et de bombardements, la Résistance, par une fermeté exemplaire, a forcé le régime occupant à accepter un cessez-le-feu. Les Brigades al-Qassam ont déclaré dans un communiqué que, malgré sa supériorité militaire et technologique, l’ennemi avait échoué à récupérer ses captifs par la force, et que, comme la Résistance l’avait promis, les prisonniers ne reviendraient que par la négociation. Cette déclaration résumait la réalité du champ de bataille : l’effondrement total de la doctrine du « recours à la force », pierre angulaire de la stratégie sécuritaire d’Israël depuis sa création.
L’échange de prisonniers palestiniens portait un message humain et social profond. Les scènes du peuple de Gaza accueillant leurs fils et leurs filles montraient que, malgré les années de guerre, de blocus et de destruction, la société palestinienne restait unie et intérieurement intacte. Ce retour ne représentait pas seulement la libération d’individus, mais la renaissance d’un esprit collectif et de la mémoire historique de la résistance — comme si chaque prisonnier libéré incarnait la volonté indomptable de la nation palestinienne.
Sur le plan stratégique, cet échange marque la consolidation d’une dissuasion mutuelle entre la Résistance et le régime occupant. Pour la première fois, le régime sioniste reconnaissait que, sans le consentement de la Résistance, il ne pouvait atteindre aucun objectif militaire ou civil. Cette réalité a gravement terni l’image de l’armée israélienne dans l’opinion publique, tant intérieure qu’internationale, tout en élevant le statut de la Résistance comme acteur décisif dans la définition de l’avenir de la Palestine.
Bien qu’enregistré extérieurement comme un accord de paix et de cessez-le-feu, l’accord de Charm el-Cheikh est en réalité une reconnaissance explicite de la victoire de la Résistance — le triomphe de la volonté sur l’armement, de la persévérance sur la technologie, et de la foi sur l’occupation.
La véritable question n’est plus de savoir si Israël reprendra la guerre, mais s’il pourra jamais reconstruire la légitimité qu’il a perdue après une telle défaite.
En définitive, l’échange de prisonniers a été bien plus qu’une transaction humanitaire ; il était le moment qui a scellé la victoire de la Résistance sur une armée qui se croyait jadis invincible. Cet événement historique a prouvé qu’aucune puissance militaire ne peut vaincre la volonté d’un peuple qui se dresse pour sa liberté.