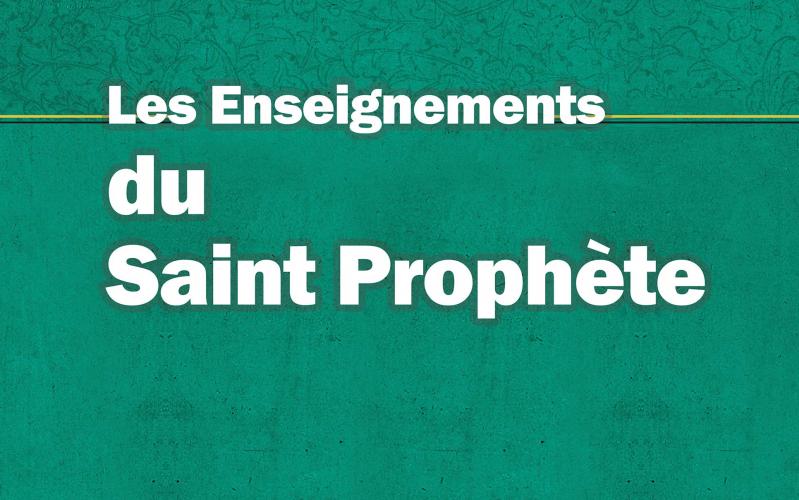L’héritage arraché de l’emprise américaine : Les racines de l’hostilité des États-Unis envers la nation iranienne avant et après la Révolution islamique
*Muhamad Mahdi Rahimi, journaliste et chercheur
« Merci beaucoup pour vos assurances qu’il n’y aura pas de convoitise sur nos champs pétrolifères en Iran et en Irak. » [1]
Cette phrase est extraite d’une lettre écrite par Winston Churchill, Premier ministre britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, à Franklin D. Roosevelt, président des États-Unis, quelques mois avant le lancement de la campagne européenne de l’Amérique en 1944. Ces mots, composés au plus fort de la dépendance de la Grande-Bretagne envers le soutien financier et militaire américain, révèlent la valeur inestimable que ces ressources représentaient pour la Grande-Bretagne. Mais quelle était l’histoire de ce pétrole ?
En 1901, William Knox D’Arcy acquit, par un accord de concession de soixante ans, les droits d’extraction du pétrole de vastes régions de l’Iran, s’étendant du nord-est au sud-ouest. Il s’engagea à fournir un paiement initial en espèces et, en plus, à verser à l’Iran seize pour cent des bénéfices annuels de la compagnie. Huit ans plus tard, en avril 1909, un an après que le pétrole eut jailli des puits de l’ouest et du sud-ouest de l’Iran, une grande société fut établie à Londres sous le nom d’Anglo-Persian Oil Company, avec un capital de deux millions de livres et le gouvernement britannique comme actionnaire. Cette compagnie, qui a subi plusieurs changements de nom, a finalement jeté les bases de l’une des plus grandes compagnies pétrolières au monde, British Petroleum (BP).
Cette compagnie devint si vaste qu’avec la fin de la Première Guerre mondiale et l’effondrement de l’Empire ottoman, lorsque la Grande-Bretagne et la France se partagèrent l’Asie occidentale comme un gâteau, la Grande-Bretagne s’empara du contrôle du pétrole des provinces les plus riches de l’Irak, comme Bagdad, Bassora, et plus tard une partie de Mossoul, grâce aux installations et à la puissance de cette même compagnie. Pourtant, après la Seconde Guerre mondiale, l’Empire britannique commença à décliner, cédant progressivement sa place aux États-Unis.
Il est temps de réclamer l’héritage
Dès le moment où les États-Unis décidèrent d’entrer dans la Seconde Guerre mondiale, ils se préparèrent à façonner un ordre mondial bâti sur la domination. Avec la fin de la guerre et l’épuisement des puissances européennes, ce fut l’Amérique qui commença à établir son contrôle sur l’ordre sécuritaire et économique du monde entier, étendant ses bases militaires et fondant des organisations internationales comme les Nations Unies et la Banque mondiale. Cette façade légale, cependant, cachait un océan de manœuvres illicites, de coups d’État, de guerres d’agression et de crimes. Chaque mouvement d’indépendance était forcé soit de s’aligner sur le Bloc de l’Est, soit de se conformer aux politiques hégémoniques de l’Amérique. Une troisième voie était inconcevable. L’Iran faisait partie des nations qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, s’engagèrent dans une lutte pour l’indépendance et pour la récupération des droits qui avaient été piétinés pendant la domination britannique. Cette lutte se confronta rapidement à la nouvelle réalité mondiale : L’ancienne puissance coloniale avait été affaiblie, et la jeune puissance coloniale était désormais désireuse de recueillir l’héritage.
Le cas de l’Iran
Peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le peuple iranien, mené par le clergé musulman et les mouvements nationalistes, se souleva pour nationaliser l’industrie pétrolière et l’arracher au contrôle britannique. Une pression persistante sur le jeune Chah d’Iran aboutit à la nomination de Mohammad Mossadegh au poste de Premier ministre, et mars 1951, l’Iran adopta une loi qui révoqua tous les droits de la compagnie britannique d’exploration, d’extraction et d’exploitation du pétrole iranien. Immédiatement après l’adoption de cette loi, la Grande-Bretagne déposa une plainte contre l’Iran devant la Cour internationale de Justice de La Haye. Pourtant, puisque la compagnie pétrolière britannique était privée, la Cour refusa de rendre un jugement, et l’Iran ne fut pas condamné. La Grande-Bretagne, avec le soutien d’autres nations occidentales, imposa alors une série de sanctions contre l’industrie pétrolière iranienne. Cela créa l’ouverture parfaite pour que la jeune puissance coloniale entre en scène.
La nationalisation de l’industrie pétrolière iranienne démontra aux États-Unis que le peuple iranien était prêt à résister et à se sacrifier pour poursuivre son indépendance et sa libération de la domination étrangère. Cet esprit et cette vision devaient être réprimés, et l’Amérique jugea le moment opportun. La nationalisation de l’industrie pétrolière iranienne par un gouvernement démocratique renforça considérablement les hommes d’État iraniens. Les tensions avec le Chah s’intensifièrent, et les partis antimonarchistes ainsi que les journaux et périodiques devinrent de plus en plus proéminents.
L’existence de factions prosoviétiques au sein de ces mouvements et publications fournit aux États-Unis un prétexte commode pour intervenir et consolider davantage son influence dans la région.
Le conflit entre le Chah et Mossadegh, et la fuite subséquente du Chah d’Iran, pavèrent la voie pour que les services de renseignement américains investissent dans des généraux monarchistes et renversent le gouvernement de Mossadegh. Le 19 août 1953, l’opération Ajax fut menée en Iran. Pendant ce coup d’État, beaucoup furent tués, Mossadegh fut arrêté et exilé, et le Chah retourna en Iran pour inaugurer un règne de vingt-cinq ans de despotisme. Cette dictature, qu’il devait aux États-Unis, fut marquée dès le départ par la gratitude envers Washington, alors qu’il attribua une part de quarante pour cent de l’industrie pétrolière iranienne à des compagnies américaines en retour de leur faveur.
Un pantin, un gendarme et l’Île de Stabilité pour l’hégémon
Les vingt-cinq ans entre le coup d’État et la victoire de la Révolution islamique rendirent l’Iran aussi précieux aux yeux de l’Amérique qu’il l’avait été autrefois pour Churchill. Au milieu de la Guerre froide, avec l’influence soviétique qui se répandait dans le monde arabe, les États-Unis tenaient désormais fermement l’Iran et l’Arabie Saoudite, les deux acteurs régionaux majeurs, dans leur emprise.
L’Iran Pahlavi avait été réduit à un simple pantin, exécutant les plans régionaux et transrégionaux de l’Amérique. Lorsque le siège serré des États arabes menaça d’étouffer le régime sioniste dans ses guerres avec les pays voisins, ce fut la monarchie Pahlavi qui maintint ouvert le cordon pétrolier, évitant l’effondrement d’Israël. Alors que le régime baasiste en Irak cimentait son alliance avec l’Union soviétique, le gouvernement du Chah arma des groupes kurdes le long de la frontière pour saper Bagdad. Lorsque les États-Unis peinèrent à soutenir la logistique de leur guerre brutale au Vietnam, ce furent des jets de combat et des pilotes iraniens, entraînés sur le sol américain, qui furent dépêchés pour faire pleuvoir des bombes sur le peuple vietnamien. Pendant ce temps, un réseau de bases fut établi à travers l’Iran pour surveiller l’activité soviétique, et plus de vingt-cinq mille personnels militaires américains, sous le titre de « conseillers », commencèrent leurs opérations dans le pays.
Toutes ces concessions accordées par le Chah d’Iran aux États-Unis, combinées aux achats militaires extensifs de l’Iran, aux investissements dans les industries et marchés occidentaux, et aux efforts pour éradiquer la culture religieuse de la société iranienne, avaient transformé l’Iran en une « Île de Stabilité » |2] dans la région, un bastion conçu pour assurer la domination de l’Amérique sur l’Asie occidentale.
Les illusions perdues
La Révolution islamique de 1979 infligea un choc complet aux États-Unis. Au-delà des énormes intérêts économiques qu’elle perdit, l’Amérique fut dépouillée d’un instrument régional vital. Avec l’aide de l’Iran, les États-Unis avaient réussi à détourner de graves menaces du régime sioniste, et après les Accords de Camp David, l’avant-garde des nations arabes dans la lutte contre le régime sioniste s’était complètement retirée de ce combat. Maintenant, cependant, c’était la Révolution islamique en Iran qui insuffla une nouvelle vie à la cause de la Palestine. Non seulement la trajectoire régionale de l’Iran s’inversa dans les questions fondamentales, mais la Révolution ouvrit aussi une troisième voie devant les nations musulmanes et les peuples en quête de liberté. L’indépendance était désormais concevable, et les deux lames des blocs de l’Est et de l’Ouest n’apparaissaient plus comme un destin inéluctable. C’est cette troisième voie et sa vision directrice qui donnèrent naissance au Front de la Résistance dans la région, confrontant les plans de l’Amérique pour l’Asie de l’Ouest à un défi existentiel. Cet horizon nouveau retarda Washington pendant plus de quatre décennies avant qu’il ne puisse à nouveau ramener certains gouvernements régionaux sur le chemin de la normalisation des relations avec le régime sioniste. Pourtant aujourd’hui, la fureur des peuples de la région envers ces États normalisateurs est bien plus grande que jamais, car devant eux se dresse le modèle de la Révolution islamique et du Front de la Résistance.
Il est peut-être plus facile maintenant de comprendre pourquoi, dès le premier jour de la Révolution islamique, l’Amérique a cherché soit à la dévier de son chemin, soit à la détruire. Comme l’a déclaré l’Imam Khamenei le 8 janvier 2025, « les États-Unis avaient revendiqué la propriété de ce pays, et que ce pays leur a été arraché. Leur ressentiment envers le pays et la Révolution, est comme la rancune du chameau ! Ils ne renonceront pas aussi facilement. […] Les États-Unis ont été vaincus en Iran, et cherchent à riposter à cette défaite. » [3]
L’Iran, le trésor que Winston Churchill chercha à protéger des États-Unis dans les jours les plus sombres de sa vie, le trésor qui resta entre les mains américaines pendant vingt-cinq ans, repose désormais entre les mains du peuple iranien lui-même. Cela, plus que toute autre chose, explique l’hostilité constante de l’Amérique envers la nation iranienne, à la fois avant et après la Révolution islamique. L’Iran était l’héritage colonial de la Grande-Bretagne, et son peuple l’a arraché de l’emprise américaine.
(Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Khamenei.ir.)
Sources :
[2] https://www.presidency.ucsb.edu/documents/toasts-the-president-and-the-shah-state-dinner-tehran-iran
[3] https://french.khamenei.ir/news/14633