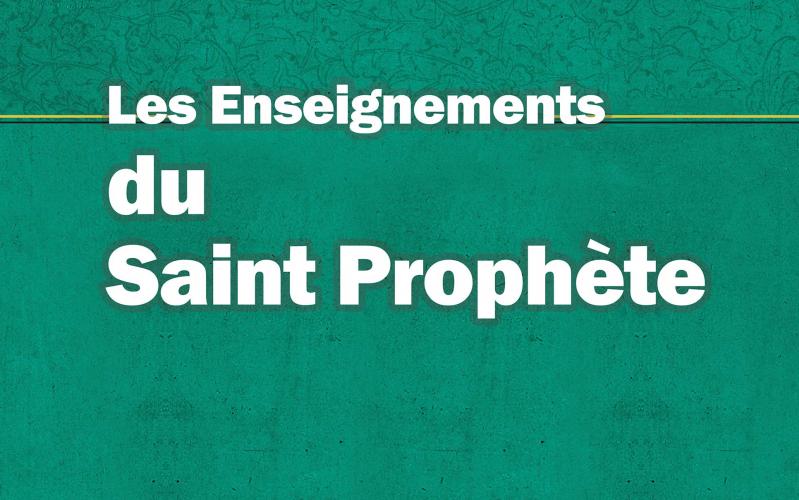KHAMENEI.IR a réalisé une interview avec le Dr Kamal Kharrazi (président du Conseil stratégique des relations étrangères), examinant les principes régissant la politique étrangère de la République islamique à travers l’étude des expériences passées, et expliquant les leçons et les enseignements tirés de la guerre de 12 jours. Ce qui suit est un extrait de cette interview :
Quelle était la sagesse des négociations avant la guerre de 12 jours ?
La diplomatie est une nécessité, et tout au long de l’histoire, elle a été utilisée pour résoudre les questions et les problèmes d’un pays. Même à l’époque du vénéré Prophète de l’Islam, nous voyons que la diplomatie était pratiquée, notamment par l’envoi d’un groupe de musulmans en Abyssinie et par les lettres que le Prophète Muhammad (que la paix soit sur lui) adressait aux dirigeants d’autres pays.
Ainsi, ce qui est important, ce sont les principes sur lesquels repose la diplomatie, et le Guide suprême de la Révolution islamique a énoncé à cet égard trois principes : la « Dignité », la « Sagesse » et l’« Intérêt ».
Nous avons également observé cela dans les événements récents, avant la guerre ; car, premièrement, accepter des négociations indirectes était en soi un signe de « Sagesse ».
C’est précisément pour cette raison que le Guide suprême de la Révolution islamique a accepté des négociations indirectes, car, dès le début, il existait des doutes quant à savoir si les Américains voulaient réellement des négociations sérieuses fondées sur les principes qui régissent le dialogue politique.
Il a accepté des négociations indirectes parce qu’il n’était pas convaincu que ces discussions mèneraient quelque part, ni qu’elles se dérouleraient dans la dignité ; ainsi, cette même attitude montrait la sagesse avec laquelle il avait accepté les négociations, mais dans le cadre de négociations indirectes.
Eh bien, si l’Iran n’avait pas accepté les négociations et que les Américains avaient eu recours à des opérations militaires, la question se serait posée : « Pourquoi n’avez-vous pas négocié pour empêcher que cela ne se transforme en guerre ? »
Mais nous avons accepté d’engager des pourparlers et nous avons négocié sincèrement pendant cinq tours, et ils étaient même en passe d’aboutir à un résultat. Cependant, les Américains sont venus et nous ont attaqués.
Tout au long de ces négociations, nous avons toujours gardé à l’esprit la dignité de la République islamique, nous n’avons conclu aucun accord contraire à cette dignité, et nous avons toujours insisté sur « le droit de l’Iran à l’enrichissement » ; mais, en même temps, une certaine flexibilité a également été montrée dans les négociations afin de parvenir à un résultat. Ainsi, l’expérience de ces trois principes était pleinement observable dans ces discussions nucléaires.
L’Iran a cherché une négociation logique jusqu’au dernier moment, même à New York
Compte tenu du résultat que nous avons obtenu des récentes négociations, nous avons constaté, dans le domaine nucléaire, qu’ils ne croient pas à une négociation logique et qu’ils veulent imposer à l’Iran des restrictions allant au-delà de la question nucléaire. Or, naturellement, la question des missiles et celle de la résistance ne sont pas des sujets sur lesquels l’Iran souhaite entrer en négociation. Par conséquent, il n’y a pas d’autre choix que de refuser de se soumettre à de telles négociations, tout en exposant notre logique à l’opinion publique et en exprimant notre disposition à un dialogue fondé sur des principes.
Bien entendu, nos négociateurs ont toujours sincèrement cherché à ne pas fuir le terrain de la négociation. Lors du récent voyage du Président et du Ministre des Affaires étrangères à New York, de grands efforts ont été déployés pour qu’une véritable négociation ait enfin lieu et aboutisse, même dans les derniers instants. Cependant, les parties adverses n’ont pas accepté. Cela montre que notre logique est solide, que la leur ne l’est pas, et qu’ils cherchent à atteindre leurs objectifs en recourant à la force.
Plus de 20 ans d’expérience de promesses de levée des sanctions en échange de la suspension de l’enrichissement nucléaire.
La République islamique n’a jamais fui la diplomatie ni la négociation. Sous le gouvernement du président Khatami, les négociations nucléaires avec les Européens ont commencé et les discussions progressaient ; cependant, ils ont fait preuve d’exigences excessives. Lorsqu’ils ont rencontré et négocié avec M. Rouhani à Sa’dabad, ils ont déclaré : « Vous devez suspendre l’enrichissement afin que nous puissions parvenir à un résultat mutuellement acceptable. »
Nous avons donc instauré la suspension, mais ensuite ils ont dit : « Nous devons obtenir une garantie objective que vous ne poursuivez pas un programme d’armes nucléaires. » Nous avons répondu : « Nous aussi, nous avons besoin d’une garantie solide que vous lèverez les sanctions. »
En pratique, cependant, ils n’étaient pas prêts à lever les sanctions et voulaient simplement transformer cette suspension en un arrêt permanent. C’est pourquoi, dans les derniers jours de la présidence de M. Khatami, la suspension a été rompue, car il s’est rendu compte que poursuivre ce processus ne mènerait nulle part et qu’ils cherchaient simplement à imposer à l’Iran un arrêt de l’enrichissement.
Comme je l’ai mentionné, au sein même de l’administration de M. Khatami, tout le monde est parvenu à la conclusion que poursuivre ce processus ne menait véritablement nulle part et ne faisait que nuire aux droits de la République islamique ; c’est pourquoi ils ont rompu la suspension, lancé l’UCF (Usine de Conversion de l’Uranium) à Ispahan, et ainsi une nouvelle phase a commencé, car la dignité et l’honneur de la République islamique exigeaient que nous ne nous soumettions pas à leur coercition ni à leurs manœuvres politiques.
Dans les périodes ultérieures, comme il y avait le sentiment qu’une véritable disposition à négocier existait, les négociations sur le JCPOA ont été menées sous l’administration de M. Rouhani, et des résultats ont été obtenus. Cependant, en pratique, nous avons constaté que les Américains n’ont pas coopéré dès le départ et qu’ensuite, sous la présidence de Trump, ils se sont retirés des négociations. Les Européens n’ont pas non plus rempli leurs engagements.
Cela montre que, bien que nous ne devions pas fuir la négociation et que nous devions être à la table des discussions, nous devons également veiller à ne rien accepter qui nous soit imposé et, si l’on tente de nous imposer quoi que ce soit, nous devons nous y opposer. Dans nos interactions récentes avec les Européens, le même processus s’est produit : nous étions prêts à négocier, mais ils ont cherché à nous imposer leur volonté. Ils ont fixé trois conditions, stipulant que si ces trois conditions étaient remplies, ils retarderaient le mécanisme de déclenchement (« snap-back ») de six mois ; même à cet égard, nous avons montré une certaine flexibilité, mais ils n’étaient pas prêts à accepter ces points.
Si la négociation repose sur des principes logiques et que la dignité de la République islamique est respectée, nous sommes prêts à négocier ; même maintenant, nous sommes prêts à négocier, à condition que les principes directeurs de la négociation soient observés.
Similitudes et différences entre la guerre de 8 ans et la guerre de 12 jours
La guerre de 12 jours et la guerre de 8 ans partagent de nombreuses similitudes tout en présentant également des différences significatives.
Dans les deux guerres, nous nous sommes appuyés sur nos propres forces et avons fourni l’armement nécessaire en utilisant les ressources disponibles. Dans la guerre de 8 ans, bien sûr, il y avait beaucoup d’armes en Iran, mais nous devions les produire et les utiliser nous-mêmes. La motivation, la capacité à défendre le pays et la préparation des combattants de l’Islam, présents sur le terrain avec un moral élevé, étaient évidentes tant dans la guerre de 8 ans que dans la guerre de 12 jours. De plus, le soutien populaire a été un facteur déterminant. Dans la guerre de 8 ans, c’est ce soutien populaire qui nous a permis de poursuivre la guerre, et le peuple était présent à la fois sur le front et dans les coulisses. Dans la guerre de 12 jours également, la solidarité nationale et le soutien populaire ont été très déterminants. Ce sont les fils conducteurs communs aux deux conflits.
En termes de différences, le paradigme gouvernant les guerres a changé. À l’époque de la guerre de 8 ans, les conflits étaient principalement industriels et dépendaient des forces humaines au sol. L’ennemi était présent sur le front, et nos forces étaient sur le front opposé. Des volontaires étaient mobilisés et affrontaient l’ennemi face à face. Les principaux outils de guerre provenaient de l’industrie militaire : artillerie, chars et armes lourdes. Ainsi, autrefois, le paradigme industriel régissait les guerres, alors qu’aujourd’hui ce n’est plus le cas. Aujourd’hui, le paradigme des guerres est informationnel et technologique. Le renseignement joue un rôle très important et son acquisition repose sur les nouvelles technologies. L’intelligence artificielle (IA) est utilisée dans les guerres pour identifier, décider, puis agir.
Trois leçons tirées de cette guerre de 12 jours
La première est de maintenir de manière persistante notre autosuffisance. La seconde est de maîtriser le nouveau paradigme de la guerre, qui est la guerre informationnelle et cognitive, afin de pouvoir répondre efficacement à nos ennemis. La troisième est de maintenir la confiance dans le peuple et la solidarité nationale qui s’est formée dans la société ; de telle sorte que le peuple, en tant que principale base de soutien du pays, soutienne les actions de la République islamique.
Lorsque le peuple est présent, on peut mieux et plus fortement défendre le pays contre les ennemis. Tous les efforts des étrangers sont dirigés vers la détérioration de notre unité nationale et pour décourager le peuple de soutenir la République Islamique. Mais si nous maintenons notre confiance dans le peuple et dans nos propres capacités, et si nous maîtrisons les nouveaux paradigmes de la guerre moderne, nous pouvons très bien défendre notre identité, notre honneur et notre souveraineté.
Nous devons être prêts à résister au plan du « Grand Israël ».
Les Israéliens, se fondant sur les mythes de la Torah, revendiquent certains droits pour eux-mêmes ; l’un de ces droits d’après eux serait qu’ils doivent posséder un vaste territoire, c’est-à-dire le plan du « Grand Israël ». Ils revendiquent que la terre « du Nil à l’Euphrate » doit être sous leur contrôle. M. Ben Gourion – qui fut le premier ministre d’Israël – avait déclaré que le Grand Israël devait s’étendre du Nil à l’Euphrate. M. Moshe Dayan – qui était leur homme politique et commandant de l’armée – a déclaré, après qu’ils avaient capturé le plateau du Golan : « Notre première génération a fondé Israël ; nous, aujourd’hui, avons pu étendre le territoire d’Israël ; et les générations futures réaliseront la politique allant du Nil à l’Euphrate. »
Tout cela indique un plan à long terme que les Israéliens ont pour la région et pour le monde. Les Israéliens disposent d’un protocole de vingt-quatre articles que les francs-maçons ont rédigé pour eux, et dans lequel leurs politiques à long terme apparaissent de manière totalement évidente.
Les sionistes revendiquent une gouvernance mondiale et veulent, un jour, dominer le monde ; sur cette voie, ils croient en une « violence sacrée », tout comme Daech. De la même manière que Daech considérait toute action comme permise pour atteindre ses objectifs, les Israéliens adoptent la même approche. Les groupes extrémistes parmi eux – comme le groupe « Goush Emounim » – agissent précisément ainsi : ils attaquent les terres palestiniennes, usurpent leurs maisons et leurs terrains, et commettent des massacres ; c’est cette même croyance en une « violence sacrée » qui est mise en pratique par eux.
Par conséquent, nous devons être vigilants face aux projets futurs d’Israël pour la région et même pour le monde. Bien qu’ils constituent une petite minorité, ils veulent dominer la région et le monde en s’appuyant sur les grandes puissances. C’est pourquoi nous devons nous préparer à la résistance dès aujourd’hui.