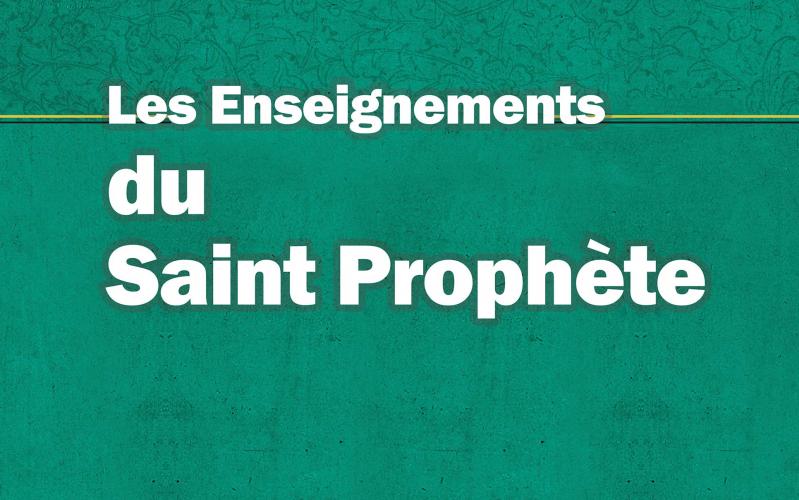La victoire de l’Iran lors de la récente guerre imposée a empêché la propagation du modèle d’agression américano-sioniste
Alireza Zadbar, chercheur en Histoire contemporaine
Le 16 juillet 2025, lors d’une réunion avec les hauts responsables du pouvoir judiciaire, l’Imam Khamenei a déclaré : « La nation iranienne a accompli un grand exploit lors de la récente guerre imposée. Cet accomplissement n’était pas de nature militaire. Il était du genre de volonté ; Il était du genre détermination ; Il était du genre confiance en soi. Il fut un temps, avant la Révolution, où la simple mention du nom de l’Amérique effrayait les gens, sans parler de l’affronter ou de s’y opposer. La même nation est pourtant arrivée à un point où elle se tient face à face avec cette puissance. »
Dans cet entretien avec Khamenei.ir, le Dr Alireza Zadbar, chercheur en Histoire contemporaine, affirme que la grande réalisation de la nation iranienne a été d’empêcher l’établissement d’une tendance colonialiste. Il a développé le rôle de la Révolution islamique dans la formation d’un système anticolonial puissant et a expliqué pourquoi le peuple iranien a confiance dans cette lutte.
Question : Quelle a été la grande réalisation du peuple iranien ? À première vue, ce qui s’est passé semble être une soi-disant guerre de 12 jours entre l’Iran et le régime sioniste. Mais à un niveau plus profond, certains pensent qu’il ne s’agissait pas d’une confrontation ordinaire. À votre avis, en quoi cette confrontation était-elle particulière ?
Alireza Zadbar : Ce qui s’est passé lors de la guerre de 12 jours ne doit pas être réduit à un simple affrontement entre l’Iran et le régime sioniste. Permettez-moi de commencer par ce point. Cette bataille n’était pas une guerre entre l’Iran et Israël ; il s’agissait plutôt d’un projet à multiples couches, conçu par l’Occident et les Hébreux, avec les États-Unis en point central. Si l’on veut raconter la grande action accomplie par la nation iranienne, il ne faut pas la considérer simplement comme une confrontation avec un petit régime illégitime. La réalité est que les États-Unis d’Amérique, plusieurs mois avant le début de la guerre — à une époque où Biden était encore président et Trump n’était pas encore revenu au pouvoir — étaient déjà en train de planifier l’opération, et même les exercices sur le terrain avaient été réalisés.
Le régime sioniste, en soi, n’a fondamentalement pas la capacité d’affronter des États-nations. Comparé à l’Iran en termes de géographie, population, infrastructures, superficie, caractéristiques civilisationnelles et historiques, Israël n’a pas la capacité d’entrer dans des guerres de longue durée. Sa stratégie militaire a été, dès le départ, fondée sur des guerres éclair et surprises ; exactement ce qui s’était produit lors des guerres avec l’Égypte, la Jordanie et la Syrie. Mais l’application d’un tel modèle face à l’Iran nécessitait une assistance fondamentale et internationale, ce qui s’est produit, notamment avec le soutien opérationnel et de renseignement des États-Unis et de certains pays européens.
Ce que le peuple iranien a accompli, ce n’est pas seulement une résistance face à Israël, mais une opposition à un projet vaste et complexe. Les Occidentaux avaient essayé pendant des années, à travers des opérations médiatiques, de préparer l’opinion publique mondiale, et de justifier une attaque contre l’Iran sous le prétexte d’empêcher l’accès à la bombe atomique. En pratique, cependant, ce que nous avons observé n’était pas seulement un bombardement d’installations nucléaires. Des zones civiles, des centres du Croissant-Rouge, la police, les services sociaux, des places publiques ont été visés, et environ mille martyrs parmi la population civile — des enfants, des nourrissons, des adolescents et des personnes âgées — ont perdu la vie. Fordo, qui était leur principal prétexte, a été bombardé même dans les derniers jours de la guerre.
Plus important encore, il y a eu des tentatives du régime sioniste pour éliminer les dirigeants politiques du pays, y compris le président, le président du Parlement et le chef du pouvoir judiciaire. Cette guerre ne portait donc pas uniquement sur le nucléaire. Son objectif était de provoquer l’instabilité, de porter un coup psychologique, d’assassiner les responsables, et finalement, de provoquer l’effondrement du système politique et la dislocation du pays. Ce qui a eu lieu était une combinaison d’opérations militaires, cybernétiques, de guerre psychologique, d’utilisation de drones, de micro-drones et de guerre électronique ; un modèle rare, voire sans précédent, dans l’histoire des guerres contemporaines.
Si ce modèle avait réussi, et si l’Occident avait atteint son objectif de renverser le gouvernement iranien, d’instaurer l’insécurité et de diviser le pays, cela serait devenu un modèle pour attaquer d’autres nations indépendantes ; comme ce que nous avons vu en Libye et en Syrie. Mais ce qui s’est passé, c’est que le peuple iranien s’est dressé face à une volonté malveillante et coloniale. Cette résistance n’a pas seulement été menée pour préserver sa propre indépendance, mais aussi pour défendre celle des autres nations. C’était un acte grandiose.
Il est important de noter que ce comportement hostile des Occidentaux et des Américains n’est pas le résultat d’un ou deux jours. L’historique des actions anti-iraniennes des États-Unis remonte à plus de 47 ans ; depuis l’abattage d’un avion de ligne iranien dans le golfe Persique, au soutien apporté à l’Irak durant la guerre imposée, en passant par des sanctions lourdes et multiformes. Par conséquent, la guerre de 12 jours est le prolongement de ces politiques hostiles, et non un événement nouveau.
Si aujourd’hui la nation iranienne reste debout, si ce projet a échoué, cela témoigne de la capacité de résilience sociale, de la cohésion nationale et de la vigilance politique du peuple iranien. Nous avons le devoir de raconter correctement cet événement et d’éviter de le réduire à un conflit entre l’Iran et Israël ou à une simple crise nucléaire. Cette guerre est un tournant dans l’histoire de la résistance du peuple iranien, et un symbole de l’échec des plans coloniaux modernes.
Question : L’Imam Khamenei a considéré la détermination et la volonté de la nation iranienne comme un facteur crucial dans la confrontation et la victoire contre Israël et les États-Unis. À votre avis, pourquoi l’élément de la volonté et de la résolution de l’individu musulman iranien est-il si significatif à cette époque et dans cette confrontation ? Sous quels aspects faut-il l’examiner ?
Alireza Zadbar : Dans sa définition classique, la guerre consiste à imposer sa volonté à autrui par la force. Depuis l’aube de l’humanité, la guerre est la jumelle de l’homme, et chaque époque de l’histoire a été témoin d’un affrontement armé entre des volontés opposées. Mais au cœur de la guerre, ce qui est déterminant, ce ne sont pas seulement les outils, mais bien les volontés ; la véritable guerre est le champ d’affrontement entre les volontés des nations.
Dans la guerre récente, ce qui s’est produit n’était pas simplement un combat d’armements, mais un affrontement entre deux volontés : la volonté de la nation iranienne contre celle d’un régime illégitime et malveillant nommé régime sioniste, dont l’existence remonte à peine à 1948. Le plan de l’ennemi était, à travers des attaques violentes, l’élimination des dirigeants du pays et l’incitation du peuple à se soulever, de reproduire en Iran le modèle déjà échoué en Syrie et en Libye. Les appels de Netanyahu et de Trump au changement de régime et à l’agitation dans les rues témoignaient de ce projet.
Leur présupposé était que le peuple s’était éloigné du système, et qu’en affaiblissant l’autorité, les rues se rempliraient, et la pression interne mènerait à l’effondrement. C’est pourquoi un vaste plan médiatique et psychologique fut conçu, impliquant différentes oppositions – depuis des groupes armés comme les OMK jusqu’aux figures de propagande comme Reza Pahlavi. Mais à cette étape, les missiles et les drones ne sont plus ceux qui combattent ; ici, c’est la conscience nationale des Iraniens qui entre en scène.
Contrairement aux prévisions, la nation iranienne a adopté un comportement enraciné dans son identité historique. Les Iraniens ne sont pas une nation récente, ni une nation née après la Seconde Guerre mondiale, mais bien une civilisation ancienne, une culture profondément enracinée, une histoire pleine d’épreuves. Une nation qui ne s’est pas constituée autour d’une tour dans sa capitale ni née de l’ingénierie coloniale, mais qui a lutté à travers l’histoire, connu victoires et défaites, et s’est à chaque fois reconsolidée davantage dans les crises.
L’ennemi s’attendait à ce que, comme dans certains pays de la région, le peuple fuie, pille les magasins ou quitte le pays. Mais malgré la fermeture de l’espace aérien, et bien que l’Iran ait 15 voisins terrestres et maritimes, les Iraniens ne se sont pas enfuis ; ils n’ont montré ni peur ni chaos, et leur comportement reflétait une maturité nationale. Cela témoigne de la puissance cachée dans l’identité nationale des Iraniens.
Mais ce n’est pas seulement la nationalité qui a formé cette volonté. La religion, et en particulier le chiisme, a été le deuxième pilier de la puissance des Iraniens dans la guerre récente. Des concepts religieux tels que le martyre, le djihad, la résistance et l’espoir du salut à travers le sacrifice ont alimenté les sources de courage et de résilience nationale. Contrairement aux efforts occidentaux pour discréditer le concept de djihad à travers les groupes takfiris, ces notions en Iran sont enracinées dans une culture religieuse vivifiante.
À l’époque contemporaine, nationalité et religion ont trouvé une cohésion dans le cadre du système de la République islamique, sous la direction du Guide suprême. Cette cohésion est le secret du pouvoir de la République islamique. Si, par le passé, les Iraniens disposaient des mêmes éléments, mais avec des régimes faibles comme les Qadjars ou les Pahlavis, ils ont connu des défaites, c’était parce qu’il manquait une coordination entre la volonté politique du gouvernement et celle de la nation.
Avec la Révolution islamique de 1979, la République islamique est venue abolir la dichotomie et l’opposition entre le peuple et l’État, continuellement renforcée en Iran, et elle a généré du pouvoir.
Les planificateurs de la guerre de 12 jours visaient à détruire ce pouvoir. Pour cela, ils avaient travaillé pendant des années sur la dualité religion/nationalité, gouvernement/nation. Mais au moment décisif de la guerre, la nation iranienne a dépassé cette dichotomie. La convergence entre histoire, religion et structure politique a créé une défense passive puissante, plus efficace que toute défense militaire. En fin de compte, la nation iranienne ne s’est pas seulement opposée à l’agression militaire, elle n’a pas non plus permis que les plans internes de l’ennemi aboutissent. Cela a démontré que la force de la nation iranienne provient de son histoire, de sa religion et de sa cohésion politique, et qu’aucune puissance, avec des calculs erronés, ne peut la soumettre.
Question : Dans l’histoire de l’humanité, le processus de colonisation et d’exploitation des peuples s’est toujours appuyé sur « l’humiliation », « la peur » et « la désespérance » pour, en quelque sorte, les stériliser et les rendre vulnérables dans les conflits. Comme il est courant dans le discours des relations internationales, le simple mouvement de navires d’un pays colonisateur comme les États-Unis entraînait le changement d’un ou deux gouvernements dans la région. Mais cela ne s’est pas produit avec le peuple iranien. En dépit du plus haut niveau de menaces et des méthodes d’intimidation militaire et économique, le peuple iranien a fermement poursuivi sa résistance. Et comme l’a souligné le Guide suprême : « Lorsqu’une nation, un pays, une force militaire dans un pays se reconnaît en elle-même cette confiance de pouvoir faire face, avec fermeté, aux États-Unis et à leur chien enragé dans la région — le régime sioniste —, le simple fait de posséder cette volonté, cette confiance en soi, constitue une valeur extrêmement importante. » Comment expliquez-vous cette caractéristique du peuple iranien ?
Alireza Zadbar : La civilisation occidentale, tout au long de son histoire, a toujours été fondée sur le monopole du pouvoir et de la production ; du Portugal et de l’Espagne jusqu’à la France et la Grande-Bretagne, chacun a, d’une manière ou d’une autre, joué un rôle de colonisateur mondial. Au XIXe siècle, l’Empire britannique possédait un réseau de colonies si vaste que « le soleil ne s’y couchait jamais ». Ces puissances, qui détenaient la gestion du monde, ne se contentaient pas de produire des marchandises, mais cherchaient aussi, en produisant des idées, des cultures et des modes de vie, à façonner l’ordre mondial.
Dans cette vision coloniale, le monde est divisé entre quelques producteurs occidentaux et de nombreux consommateurs périphériques. Des termes comme « premier et tiers monde », « Nord et Sud », ou « pays développés et en développement » reflètent tous ce monopole. Le maintien de ce monopole a facilité la croissance du colonialisme. La première génération du colonialisme se caractérisait par l’occupation physique et militaire des pays, mais son coût élevé a poussé l’Occident vers de nouvelles formes de colonisation.
Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une nouvelle génération de colonialisme ; le colonialisme moderne ne procède plus par expéditions militaires, mais installe des dirigeants dépendants et paralyse la volonté politique des États de l’intérieur. Les gouvernements dépourvus d’indépendance et soumis aux intérêts de l’Occident agissent comme instruments du colonialisme non militaire. L’Iran, sous l’ancien régime Pahlavi, est un exemple de cette structure dépendante, dont les comportements politiques obéissaient à la volonté de la Grande-Bretagne ou des États-Unis.
Par conséquent, une autre forme de colonialisme, sur laquelle les Occidentaux ont davantage investi, est le colonialisme intellectuel. C’est-à-dire qu’ils colonisent les esprits des élites, des intellectuels, des personnalités dans les pays. Ils les intègrent dans leur sphère d’intérêts, les forment par divers langages, méthodes, théories, et en occupant les espaces académiques, ils transforment leurs nations en colonies mentales et intellectuelles de l’Occident.
Le peuple iranien, toutefois, possède dans son histoire une longue expérience de lutte contre le colonialisme ; des traités de Golestan et de Turkmanchay, au mouvement du tabac et au mouvement de nationalisation du pétrole, des personnalités religieuses et nationales ont toujours été en première ligne de cette résistance. La protestation de Molla Ali Kani contre le contrat Reuter, la fatwa de Mirza Shirazi, le rôle de l’ayatollah Kashani aux côtés du Dr Mossadegh, et finalement le soulèvement de l’imam Khomeiny contre les États-Unis et Israël, témoignent de la continuité du désir d’indépendance des Iraniens. Le slogan d’indépendance dans la Révolution islamique d’Iran est le fruit d’une expérience historique et de luttes continues du peuple iranien contre le colonialisme, et non un événement soudain. Le peuple iranien, à travers les siècles, a connu humiliation, guerre, désespoir et colonialisme, mais il a toujours résisté et formé une puissance qui, aujourd’hui, se tient fièrement face au néocolonialisme. Cette résistance est le produit de la foi, de l’identité historique et de la religiosité du peuple iranien.
Question : Avant la Révolution islamique, l’Iran, durant la majorité de son histoire, entretenait une relation plutôt soumise et intimidée vis-à-vis du colonialisme et de l’impérialisme. Mais il semble qu’un changement essentiel soit intervenu après la Révolution islamique. Qu’en pensez-vous ?
Alireza Zadbar : Ici, il faut faire une distinction entre l’Iran avant et après la Révolution islamique. Les Iraniens, au moins depuis la guerre de 12 ans contre la Russie tsariste — qui s’est soldée par les traités de Golestan et de Turkmanchay, puis par la perte d’une partie du territoire avec le traité de Paris, notamment Hérat où les Anglais ont joué un rôle majeur —, ont fait face à l’influence étrangère. Même durant la Première Guerre mondiale, les Britanniques ont eu un rôle actif. Ensuite, viennent les évolutions sous Nassereddin Shah, célèbre roi Qadjar, période qu’on appelle l’époque des concessions : de nombreuses concessions ont été accordées aux Européens et aux Occidentaux. Le contrat Reuter, le contrat du tabac, le contrat de loterie, et de nombreux autres, majoritairement au profit du Royaume-Uni, de la Russie tsariste, etc. Le contrat des pêches, plus tard le contrat de 1919 qui concernait le destin du pays, ses mines, ses forêts, la construction de chemins de fer, etc.
Mais la question est : à cette époque, le peuple iranien était-il simple spectateur ? Non. Même à cette époque, les élites iraniennes, ses savants, ses patriotes protestaient. Des mouvements ont été lancés, des soulèvements ont eu lieu. Comme le mouvement du tabac, le mouvement du Jangal (forêt) dans le nord avec une figure comme Mirza Kuchak Khan Jangali. Dans le sud, des figures comme Delvari, et de nombreuses autres. Et comme je l’ai dit en réponse à la question précédente, il y a eu des fatwas pour l’indépendance. Des fatwas contre le colonialisme, émises par des chefs religieux et des marja' (autorités religieuses).
Mais quelle est la différence ? C’est qu’en 1979, le mouvement que l’imam Khomeiny avait commencé environ 15 ans auparavant a abouti à la victoire. Les Iraniens n’étaient pas spectateurs du colonialisme. Ils ont lutté. Mais l’imam Khomeiny a réussi à faire triompher le courant de l’indépendance en Iran.
D’autres ont essayé, avec des hauts et des bas, ils ont eu des victoires temporaires. Mais ce qu’a accompli l’imam Khomeiny a deux grandes différences : d’abord, il a pu amener ce mouvement à une victoire finale, en s’appuyant certes sur l’expérience des anciens. Mais la vraie différence est celle-ci : l’imam Khomeiny a réussi à fonder un système politique. Un système politique centré sur l’islam. Et l’imam croyait que l’islam, parce qu’il se dresse contre le colonialisme, contient dans ses lois, dans la jurisprudence chiite, une base juridique de résistance au colonialisme, à l’agression étrangère.
La différence, c’est que l’idée de l’imam Khomeiny n’était pas simplement de protester. Il ne s’agissait pas simplement de s’indigner à chaque fois que les Occidentaux venaient imposer un contrat à notre pays, de lancer une fatwa, d’annuler ce contrat, et que le cycle recommence. Non. Avec la Révolution islamique, un système politique basé sur le peuple a vu le jour.
Dans l’histoire de l’Iran, le peuple — au sens de nation — n’a jamais joué de rôle dans la fondation des gouvernements. Les gouvernements historiques de l’Iran étaient de type tribal. Les Qadjars étaient eux-mêmes une tribu, qui servait les Safavides. Les Safavides, à leur époque, ont réussi en unissant plusieurs tribus et en battant d’autres, et ils ont fondé leur État. Les gouvernements, dans l’histoire de l’Iran, ne se formaient pas sur la base du suffrage ou de la participation du peuple. Bien sûr, les autres pays et nations de notre région étaient aussi dans la même situation. C’était le modèle traditionnel de formation du pouvoir.
Mais avec la Révolution islamique, l’imam Khomeiny a fait participer le peuple à la révolution, à la fondation du système politique, et à sa pérennité. Dès le départ, il a instauré des élections. Il a même soumis la révolution à un référendum. Le président, le Parlement, même le guide suprême ont été désignés par le vote du peuple. Ainsi, ce changement fondamental apporté par la Révolution islamique, c’est que l’imam Khomeiny n’a pas simplement voulu des protestations ponctuelles pour ensuite retourner s’asseoir dans sa mosquée ou sa madrasa. Non. Il a fondé un système politique islamique.
Question : Si l’on pouvait, dans le cadre des études postcoloniales, forger un concept nommé « courage anticolonial », on pourrait dire que le peuple iranien, depuis la Révolution, l’a fortement incarné. Peut-on dire que le danger que représente ce courage anticolonial pour le système colonial-impérialiste est plus grand que d’autres formes de développement civilisationnel des nations anti-coloniales ? Si oui, pourquoi ?
Alireza Zadbar : Reza Khan est arrivé au pouvoir grâce au coup d’État de 1921, avec le soutien d’officiers britanniques comme le colonel Ironside. Ensuite, en 1953, le coup d’État organisé par les Américains contre le gouvernement national de Mossadegh a permis de maintenir Mohammad Reza Pahlavi au pouvoir. C’est un exemple clair du lien entre colonialisme et despotisme en Iran : l’Occident a menacé l’indépendance des Iraniens, et le despotisme des Pahlavi a restreint leur liberté.
La position géopolitique de l’Iran l’a toujours placé au cœur des intérêts des puissances mondiales ; depuis le passé où il se trouvait sur la route de la soie, jusqu’à l’ère de l’énergie avec ses vastes ressources en pétrole et en gaz. Cette importance stratégique a conduit le régime Pahlavi à jouer le rôle de shérif régional dans la doctrine Nixon ; un gendarme qui agissait à la place des États-Unis dans la région, tout en assurant les intérêts de Washington.
Avant la Révolution, le régime iranien se trouvait clairement dans l’orbite des intérêts occidentaux : de l’adoption de la loi de capitulation qui offrait l’immunité judiciaire aux Américains en Iran, à la vente de pétrole à Israël en pleine période d’embargo arabe ; du soutien militaire au régime du sultan Qabus à Oman, à l’envoi rapide de chasseurs au Vietnam, jusqu’à devenir le plus grand acheteur d’équipements militaires américains. L’armée pahlavie, en termes de structure, de formation et d’équipement, était entièrement américaine, et l’Iran était devenu l’une des bases d’armement des États-Unis dans la région.
Dans ces conditions, la Révolution islamique n’a pas seulement transformé la structure politique, mais a aussi révélé un courage et une volonté anticolonialistes chez le peuple iranien. L’Iran s’est libéré de la dépendance et a élaboré un modèle qui ne se limitait pas à rejeter le colonialisme, mais s’est transformé en une résistance continue contre l’arrogance mondiale. La différence de l’Iran avec les autres pays anticoloniaux est qu’il ne s’est pas seulement soulevé, mais a résisté à l’intégration et à l’absorption dans l’ordre mondial, et a maintenu ce modèle pendant plus de 47 ans.
De nombreux peuples en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud se sont soulevés contre le colonialisme britannique, français et américain, mais la plupart d’entre eux, après quelques années, se sont fondus dans l’ordre mondial occidental. En Iran cependant, la résistance est devenue un mode de vie. Non pas une résistance temporaire ou réactive, mais une résistance structurelle, civilisationnelle et durable. Cette continuité s’est transformée en un « modèle régional » qui a inspiré d’autres mouvements et gouvernements indépendantistes.
Les Iraniens, en plus d’avoir eu le courage de se soulever et d’agir contre l’arrogance, ont poursuivi cette voie. Autrement dit, ils ont construit un modèle, un exemple. Pendant plus de 47 ans, ce modèle s’est développé dans la région. Cette guerre a pour l’une de ses raisons le dérangement causé par ce modèle : le modèle de résistance. Pas une résistance d’un an, de deux ans, de cinq ans ou de dix ans — une résistance comme principe et comme mode de vie.
Au fil de ces années, beaucoup en Iran ont aussi tenté, par un courant pro-occidental, de faire en sorte que l’Iran finisse par être absorbé dans les équations coloniales du monde. Mais le rôle central du Guide suprême — dont la mission est de protéger la Révolution islamique — a empêché cela.