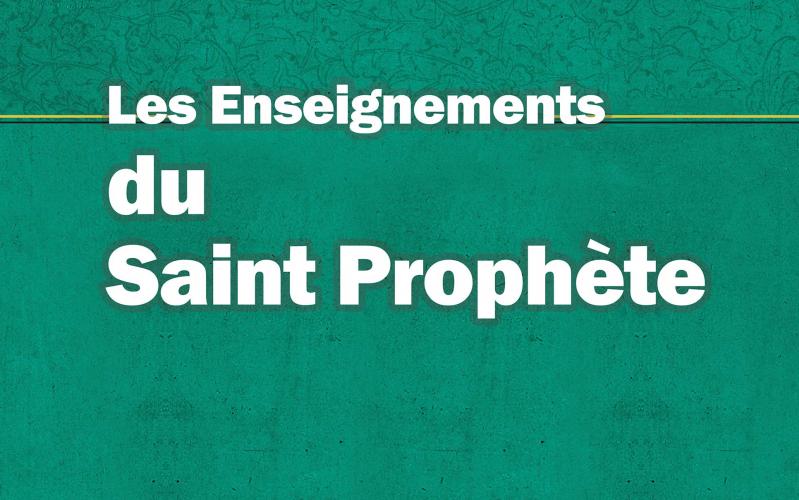Le 4 juin 2025, l’Imam Khamenei a déclaré : « Les gouvernements doivent savoir que s’appuyer sur le régime sioniste n’apportera la sécurité à aucun gouvernement. Ils ne peuvent pas assurer leur sécurité en s’appuyant sur le régime sioniste, parce que ce régime, le régime sioniste, est en train de s’effondrer, selon un décret divin certain. Et, si Dieu le veut, il ne restera pas très longtemps. Le présent article explique les causes profondes de cette réalité.
* Dr Mohsen Farkhani, chercheur en affaires palestiniennes et études sur le régime sioniste
Le régime sioniste, entité créée en 1948 sur la base de l’occupation des terres palestiniennes et du déplacement forcé des Arabes, a adopté des politiques telles que la suprématie sioniste, la division du monde arabe et une exploitation parasite des ressources régionales. Non seulement il n’a pas réussi à instaurer une sécurité durable pour lui-même, mais il est également devenu une force déstabilisatrice au Moyen-Orient. En promouvant un récit iranophobe et en formant des alliances temporaires avec certains États arabes, le régime sioniste a illusionné leurs dirigeants en leur faisant accepter sa pérennité dans la région. Cependant, l’histoire a prouvé que ce régime abandonne rapidement ses engagements dès que ses intérêts changent.
Sa nature anti-arabe – enracinée dans l’idéologie sioniste et le déni de l’identité et des droits arabes – ainsi que ses politiques expansionnistes et divisionnistes ont affaibli l’unité arabe et intensifié les tensions régionales. Comme l’a souligné à plusieurs reprises l’Imam Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique, des notions telles que la « nature anti-arabe du régime sioniste », l’attitude basée sur la « suprématie sioniste et son caractère parasitaire », ainsi que « son incapacité à instaurer la sécurité pour lui-même » montrent non seulement la présence illégitime et malveillante du régime sioniste au Moyen-Orient, mais reflètent également ses stratégies de fabrication d’ennemis fictifs, de sécurisation excessive et de déstabilisation régionale.
La nature anti-arabe du régime sioniste
La nature anti-arabe du régime sioniste se manifeste sur les plans idéologique-identitaire, militaire, politique et pratique. Sur le plan idéologique, l’un des slogans principaux du régime avant son occupation et sa formation à la fin du XIXe et au début du XXe siècle était : « une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». Ce slogan, promu par les dirigeants sionistes Theodor Herzl et Israel Zangwill, signifiait l’ignorance de la présence des Arabes palestiniens autochtones en Palestine. Les documents du Congrès sioniste mondial de 1897 prévoyaient une migration juive en Palestine sans considération pour les droits de la population arabe indigène, illustrant dès le départ le rejet de l’identité arabe.
L’idéologie sioniste insiste sur la suprématie juive comme « peuple élu ». Cette vision, issue de certaines interprétations religieuses et nationalistes du Talmud, considère les Arabes et les non-Juifs comme inférieurs, devant être soit soumis, soit écartés. En conséquence, des lois discriminatoires dans le régime sioniste, comme la « Loi sur l’État-nation juif » de 2018, marginalisent les droits des non-Juifs, notamment les Arabes palestiniens, et rabaissent l’identité arabe. Cette humiliation identitaire est allée jusqu’à chercher à effacer l’identité culturelle et historique arabe pour consolider une identité juive en Palestine. Cela comprend le changement de noms de lieux arabes, la destruction de sites du patrimoine arabo-islamique, la démolition de plus de 500 villages palestiniens après 1948 et leur remplacement par des colonies juives ou des parcs de loisirs, comme le parc Canada près d’Al-Qods, ainsi que la restriction de l’enseignement de la culture arabe.
Ces politiques ont conduit à la dégradation de l’identité arabe et à la rupture des Arabes avec leur héritage culturel. Par exemple, le changement de noms de villes arabes – comme « Umm al-Rashrash » en « Eilat » ou « Umm Khalid » en « Netanya » – fait partie de cette stratégie.
Sur le plan militaire
L’idéologie sioniste a eu recours au nettoyage ethnique pour établir un État à majorité juive. Cette politique s’est concrétisée dans des plans comme le « Plan Dalet » en 1948, visant à expulser les Arabes de zones stratégiques en Palestine. Le régime sioniste a également mené des actions militaires contre les États arabes à différentes époques. Par exemple, le bombardement du réacteur nucléaire Osirak en Irak en 1981 démontre les efforts du régime pour empêcher les progrès scientifiques et militaires des nations arabes. De plus, les attaques répétées contre le territoire syrien, notamment le bombardement de positions militaires ces dernières années, le soutien aux sanctions économiques contre des États arabes opposés, comme l’Irak dans les années 1990 et la Syrie après 2011, ainsi que la semence de divisions dans le monde arabe – comme le soutien à la coalition menée par l’Arabie Saoudite contre le Yémen – font partie de ces politiques.
Sur le plan politique
Le régime sioniste a cherché à affaiblir l’unité arabe par une stratégie de « diviser pour régner ». Par exemple, dans les années 1950 et 1960, il a exploité les tensions entre États arabes, comme la rivalité entre l’Égypte de Gamal Abdel Nasser et les États conservateurs comme l’Arabie Saoudite et la Jordanie, pour empêcher la formation d’un front arabe uni contre lui. En outre, par la diplomatie secrète et la coopération avec certains États arabes conservateurs – comme la Jordanie dans les années 1970 – il a tenté d’isoler l’Égypte en tant que leader du monde arabe. Cette politique a culminé avec les Accords de Camp David de 1978, qui ont conduit à un traité de paix entre l’Égypte et le régime sioniste, divisant le monde arabe en deux camps.
Le régime a également soutenu à certains moments des groupes séparatistes ou d’opposition dans les pays arabes pour affaiblir les gouvernements centraux, comme son soutien aux milices chrétiennes – les Phalangistes – durant la guerre civile libanaise. Cela a contribué à l’affaiblissement du gouvernement central du Liban, approfondi les divisions entre groupes arabes [sunnites, chiites et chrétiens], accru l’influence du régime au Liban et conduit à l’occupation du sud du Liban en 1982. Ce soutien incluait la fourniture d’armes, de renseignements et d’aide logistique à des groupes opposés aux gouvernements arabes.
Le régime sioniste ne s’est pas arrêté là, il est également intervenu dans les affaires internes des États arabes à travers des opérations de renseignement et d’espionnage. Lors de la tristement célèbre « Opération Susannah » ou « Affaire Lavon » de 1954, des agents sionistes ont tenté de commettre des attentats à la bombe en Égypte et d’en accuser des groupes arabes afin de nuire aux relations de l’Égypte avec l’Occident. Cette opération visait à déstabiliser le gouvernement de Gamal Abdel Nasser. Le régime a également soutenu tacitement la monarchie jordanienne contre les factions palestiniennes lors de « Septembre noir » en 1970, cherchant à affaiblir les groupes de Résistance palestinienne et à maintenir la Jordanie comme allié officieux. Ces actions ont nourri la méfiance entre les États arabes et affaibli les mouvements de Résistance arabe.
Le régime sioniste a également exploité les tensions politiques entre les États arabes pour affaiblir un front arabe unifié, comme en soutenant indirectement le différend entre le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis afin de miner le Conseil de coopération du Golfe (CCG) et réduire la coordination arabe. De plus, en soutenant le projet du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne, il a alimenté indirectement les tensions entre l’Égypte, le Soudan et l’Éthiopie, car ce projet menace les intérêts hydriques des nations arabes. En fournissant un soutien politique et militaire à des pays non arabes [comme l’Éthiopie] ou en renforçant ses liens avec certains États arabes contre d’autres, le régime sioniste a contribué à la division, réduisant la coopération régionale entre les pays arabes tout en renforçant son influence dans la région.
Suprématie sioniste et nature parasitaire du régime sioniste
Les concepts de « suprématie sioniste » et de « nature parasitaire du régime sioniste » sont deux aspects clés de ses politiques et de ses actions, tous deux enracinés dans l’idéologie sioniste et dans son comportement pratique envers les États arabes et la région – deux faces d’une même pièce. Ces deux concepts découlent de l’idéologie sioniste de suprématie juive et de domination sur la région.
La notion de suprématie fournit une justification idéologique à la privation des droits des Arabes et à leur humiliation, tandis que le comportement parasitaire est le résultat pratique de cette vision, traitant les ressources et les biens arabes comme un droit naturel et saisissable des sionistes. Dans la vision sioniste, fondée sur des enseignements talmudiques, les Arabes sont considérés comme des peuples inférieurs, soumis à une déshumanisation. Cette vision a conduit les sionistes à nier aux Arabes l’égalité des droits et l’indépendance, légitimant la saisie de leurs terres et de leurs ressources.
La nature suprématiste et parasitaire du régime sioniste a même conduit des pays comme les Émirats arabes unis et Bahreïn – qui ont établi des relations diplomatiques avec lui – à faire face à une méfiance publique et régionale. En revanche, elle a renforcé la position des groupes de Résistance tels que le Hezbollah, Ansarullah du Yémen et le Hamas dans l’opinion publique des nations arabes et islamiques, leurs actions étant perçues comme des réponses aux crimes et à l’exploitation du peuple palestinien par le régime sioniste. Des exemples clairs de la nature parasitaire du régime peuvent être observés dans les Accords d’Abraham de 2020 avec les Émirats, Bahreïn, le Soudan et le Maroc. Par le biais de cet accord, le régime sioniste a eu accès aux marchés arabes, aux technologies régionales et aux ressources économiques, tandis que les États arabes n’en ont tiré aucun bénéfice durable.
L’incapacité du régime à assurer sa propre sécurité
Malgré sa supériorité militaire, le soutien occidental massif et des systèmes de renseignement avancés, le régime sioniste est confronté à de graves défis multidimensionnels pour instaurer une sécurité durable pour lui-même. Cette incapacité résulte de plusieurs facteurs, notamment la nature occupante du régime, la résistance persistante du peuple palestinien, les tensions régionales et l’instabilité interne.
Les attaques par missiles et drones menées par les groupes de Résistance – en particulier depuis le Liban, le Yémen et Gaza – mettent en évidence l’échec du régime sioniste à créer un environnement sûr pour lui-même et pour ses habitants. Par ailleurs, les divisions politiques et sociales au sein du régime, y compris les fractures entre groupes religieux et laïques, les manifestations contre les politiques gouvernementales, la corruption étatique et les crises économiques, ont affaibli la cohésion interne. Cette instabilité affaiblit la capacité du régime sioniste à faire face aux menaces extérieures.
La corruption politique et la méfiance du public envers les institutions gouvernementales ont encore aggravé ce problème. La corruption dans les plus hautes sphères du pouvoir, y compris des accusations contre des hauts responsables comme Benjamin Netanyahu, a sapé la confiance du public dans ses institutions gouvernementales.
Dans ses relations avec les autres pays, le régime sioniste dépend fortement du soutien militaire, financier et politique des États-Unis et de plusieurs autres pays occidentaux. Cette dépendance affaiblit non seulement son indépendance stratégique, mais le rend également vulnérable aux changements dans la politique mondiale. Par exemple, en Occident, le déclin du soutien public et l’effondrement du récit victimaire du régime sioniste à la suite de crimes de guerre et du massacre de civils à Gaza – en raison de critiques liées aux violations des droits de l’homme – ont entraîné une crise de légitimité, mettant en péril la sécurité du régime.
D’un point de vue militaire et défensif, après les frappes de représailles légitimes de l’Iran – dans le cadre des opérations Promesse Véridique – même avec des systèmes de défense avancés comme le Dôme de Fer, le mythe de l’invincibilité du ciel du régime sioniste s’est effondré. Cela a instillé un sentiment de faiblesse et de vulnérabilité parmi les colons sionistes dans les territoires occupés.
Sur le plan intérieur, le régime sioniste est une société composée de groupes religieux variés – juifs orthodoxes, laïcs, réformistes – d’ethnies diverses – ashkénazes, sépharades, immigrés juifs africains et asiatiques – et de factions politiques – gauchistes, droites, partis extrémistes. Plutôt que de favoriser l’unité, cette diversité a approfondi les divisions. Les conflits entre juifs orthodoxes et laïcs sur le rôle de la religion en politique, le service militaire (duquel les orthodoxes sont souvent exemptés) et le mode de vie ont alimenté les tensions sociales. Ces divisions perturbent les grandes décisions gouvernementales, comme les politiques d’occupation ou les négociations de paix.
Ainsi, un régime incapable d’instaurer la paix sur le plan intérieur, régional ou international ne saurait être un garant fiable de la sécurité pour les pays arabes.
En fin de compte, de nombreux exemples – dont la Nakba de 1948, la Loi sur l’État-nation de 2018, l’expansion illégale des colonies et les attaques militaires contre les États arabes – témoignent de l’idéologie suprématiste du régime sioniste et de son hostilité envers les Arabes et le monde islamique. Son incapacité à établir la sécurité – découlant de la résistance continue du peuple palestinien, des tensions régionales avec des groupes comme le Hezbollah et AnsarAllah, de l’instabilité interne due aux divisions politiques et sociales, et de la dépendance à un soutien étranger – confirme l’affirmation du Guide suprême de la Révolution islamique selon laquelle le régime sioniste manque de légitimité et de viabilité à long terme dans la région. Cette instabilité, combinée à des politiques expansionnistes et de division, a non seulement empêché le régime sioniste d’assurer sa propre sécurité, mais a également exposé ses alliés arabes à la méfiance et à la vulnérabilité régionale.
(Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteure et ne reflètent pas nécessairement celles de Khamenei.ir.)
https://english.khamenei.ir/news/11800/Normal-ties-with-the-Zionist-regime-A-mirage-of-security