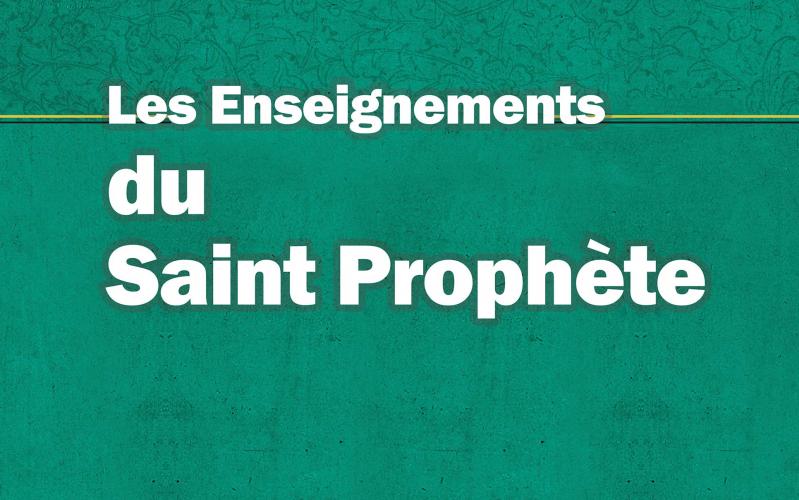Dans les sombres années du début du XIXᵉ siècle, alors que le monde rêvait encore de se reconstruire après Napoléon, Joseph Niepce et Louis Daguerre inventèrent la réalité dans les profondeurs de leurs chambres noires. La photographie devint la représentation la plus fidèle du monde jamais observée jusqu’à ce jour. Par une photographie, la réalité pouvait être enfermée dans un petit cadre et présentée directement au spectateur sans médiation – exactement comme chacun l’avait imaginé au départ.
En 1839, deux peintres français, espérant photographier la terre des Pharaons, partirent pour l’Égypte et atteignirent de là al-Quds, devenant les premiers à capturer les paysages religieux de la ville. Ce fut le début de la vague de la photographie en « Terre Sainte ». En moins d’une décennie, des centaines de photographes venus du monde entier se rendirent en Palestine – une terre sacrée pour toutes les grandes religions divines.
Pourtant, dans ces premiers cadres, aucune trace du peuple n’apparaissait. Ces photographies étaient destinées à raconter la terre éternelle du Livre saint, et non ses habitants vivants et mouvants. Les bâtiments et l’architecture prenaient place dans le cadre, tandis que le peuple de Palestine était largement absent de l’image. Si un visage apparaissait parfois, ce n’était que comme repère servant à mettre en valeur la grandeur d’une construction.
Dans les cadres européens, cette terre apparaissait comme sainte mais dépourvue de vie humaine. Contre toute attente, ces cadres vides consolidèrent un nouveau récit de la Terre Sainte dans l’imaginaire mondial : une terre destinée à demeurer à jamais dans la pensée, sans nation, sans visages, et prête pour sa prochaine conquête.
Les premiers cadres : quand la réalité fut inventée
Les décennies 1850 et 1860 marquèrent l’âge d’or de la photographie. La guerre de Sécession américaine avait transformé la photographie en un puissant médium, mais en Terre Sainte, les appareils servaient une autre mission : rechercher des preuves tangibles des récits de la Bible. Dès le départ, les cadres furent construits en effaçant le peuple ; les photographes, sortis des cendres des croisades, entreprirent à nouveau de conquérir cette terre, image après image. Pendant ce temps, des siècles de domination ottomane sur la Palestine touchaient à leur fin.
L’immigration juive avait commencé. Les photographies, en ne montrant pas les habitants, offraient aux colons une image de la Terre Sainte. Dans ces cadres inhabités prit forme la première narration d’« une terre sans nation pour une nation sans terre ». La photographie fut ainsi transformée, passant du simple enregistrement du réel à un instrument de confisquer le réel.
La Première Guerre mondiale, cette force monstrueuse qui dévora tout, culmina dans la Déclaration Balfour et la naissance du régime sioniste. Les soldats britanniques parcoururent les ruelles d’al-Quds, et les déclencheurs des appareils photo judéo-européens claquèrent à nouveau. Les nouvelles photographies montraient les mêmes vieux paysages, mais cette fois avec des légendes qui en modifiaient l’identité. La réalité fut inversée. Le peuple fut effacé, l’histoire effacée, et le cadre lui-même devint une arme coloniale.
Saisir l’image, saisir la terre
Pourtant, au cœur même d’al-Quds, durant les dernières décennies du XIXᵉ siècle, une petite école fut fondée dans l’enceinte de l’église Saint-Jacques, formant la première génération de photographes palestiniens. Garabed Krikorian, un élève assidu de cette école, fonda le premier studio palestinien dans la rue de Jaffa, où il photographia le peuple, leurs visages, leurs rituels et leurs vies. Des années plus tard, une nouvelle génération de photographes palestiniens vit le jour : Fadhel Sabbah, Khalil Raad et Karimeh Abbud. Contrairement à la génération précédente, ils sortirent des studios et utilisèrent leurs appareils pour protéger les maisons et les rues. Pour eux, la photographie n’était pas un passe-temps mais une forme de défense – une défense d’une réalité qui avait été effacée d’autres cadres.
Fadhel Sabbah, le photographe des rituels et des femmes puisant l’eau à la source d’Aïn al-Adhra (le Puits de Vierge), redonna vie au cadre. Un rituel qui, pour le peuple de Nazareth, symbolisait la fertilité et le renouveau, fut, à travers son objectif, transformé en expression culturelle de la continuité d’une nation. Khalil Raad, le gardien des orangeraies de Jaffa, s’opposa aux cadres fabriqués qui présentaient les vergers comme le fruit du travail des colons juifs.
Ses photographies d’ouvriers et de paysans palestiniens apportèrent une riposte calme et patiente à la saisie de l’image. Et Karimeh Abbud, la fille de Bethléem, devint la première femme photographe palestinienne à briser les tabous. Avec l’appareil photo que son père lui avait offert, elle parcourut les villes de Palestine et captura dans ses cadres les voix des femmes et des hommes de sa terre. Lorsque son frère perdit la vie sous la torture des Britanniques, Karimeh prit la décision de continuer à photographier jusqu’à son dernier souffle. Dans son testament, elle précisa qu’elle ne voulait pas que son appareil soit enterré avec elle ; il devait rester, pour témoigner de ce qu’elle ne verrait plus.
Les yeux qui se sont éveillés
Après la Nakba, les caméras en Palestine ne se sont pas tues. Kegham Djeghalian, durant les jours de l’occupation de Gaza, photographiait derrière les couvertures qui couvraient sa fenêtre. Il captura les déplacés, les files d’attente pour la nourriture, et les enfants jouant au milieu des ruines. Ses cadres étaient un témoignage vivant du visage changeant des villes – de la joie à la dévastation. Cependant, lorsque le récit palestinien fut ignoré, les caméras occidentales revinrent. Micha Bar-Am et les photographes des magazines Life et Time présentèrent au monde des images de la victoire du régime sioniste. Les photographies en couleur de la guerre des Six Jours et des célébrations de la victoire remplacèrent les images de souffrance et de déplacement. Une fois encore, la réalité fut fabriquée dans les studios du puissant.
Pourtant, au milieu de cette obscurité, une nouvelle génération se leva. Des jeunes qui avaient grandi dans les camps proclamèrent désormais leur identité avec des pierres et des caméras. L’Intifada fut le soulèvement des yeux qui s’étaient éveillés. Osama Silwadi faisait partie d’eux. Il commença sa photographie avec des fleurs sauvages et la poursuivit avec le sang et la fureur de l’Intifada. Ses cadres, capturant les affrontements entre femmes palestiniennes et soldats israéliens, les manifestations et les cris des rues, atteignirent le monde. Il était un photographe sous les traits d’un sniper : un chasseur des moments de vie et de mort.
Après des années de collaboration avec des agences de presse internationales, Silwadi réalisa son propre rêve : une agence de presse entièrement composée de Palestiniens. Pourtant, les balles qui transpercèrent son corps le laissèrent cloué dans un fauteuil roulant. Néanmoins, il continua à photographier, cette fois en se concentrant sur le patrimoine et la culture de la Palestine. Il croyait que si l’ennemi prenait la terre, peut-être pourrait-elle un jour être reprise, mais si l’identité et la culture étaient éradiquées, alors tout serait perdu.
Un héritage de lumière et de sang
Aujourd’hui, alors que les flammes de la guerre embrasent à nouveau Gaza et la Palestine, le monde voit les images, mais cette fois les narrateurs sont les Palestiniens eux-mêmes. De jeunes photographes comme Fatima Shabeer, Mohammed Salem et bien d’autres perpétuent l’héritage de Karimeh Abbud, Khalil Raad et Kegham Djeghalian. Leurs cadres poursuivent la même histoire : des images d’enfants endurant la froideur de la guerre, de mères en deuil, de murs en ruine et d’orangers et d’oliviers. Ces photographies crient : « nous sommes ici, et c’est notre terre ».
L’Imam Khamenei a ainsi décrit cet esprit :
« C’est un rêve illusoire d’imaginer qu’une nation puisse être effacée des pages de l’histoire et remplacée par une nation factice ! La nation palestinienne possède une culture, une histoire, un héritage et une civilisation. Cette nation vit dans ce pays depuis des milliers d’années… Il n’existe aucune puissance au monde capable d’éteindre la motivation pour la liberté et le retour de la Palestine à ses véritables propriétaires, ni à travers le monde, ni dans le cœur des nations musulmanes, et encore moins dans le cœur même de la nation palestinienne. » [20 octobre 2000]
Les cadres palestiniens ne sont pas de simples photographies ; ils sont l’histoire vivante d’une nation, une histoire inscrite dans le sang, la lumière et les négatifs photographiques. Des chambres noires de Paris aux rues en ruine de Gaza, il existe un chemin continu : la lutte pour voir, pour demeurer et pour raconter. Dans un monde qui a appris des premiers cadres comment construire la réalité, les Palestiniens ont appris à la reconquérir.
Ils endurent encore – dans chaque image capturée des ruines, dans chaque visage qui regarde hors du cadre. C’est comme si l’esprit des photographes historiques de la Palestine avait été insufflé dans les corps de leurs enfants.
Au milieu de la poussière, une lumière brille encore. Et dans chaque négatif traversé par le sang, une image vivante de la patrie ancestrale est imprimée : la Palestine, avec tous ses cadres.
(Cet article est adapté du documentaire « Palestinian Frames », réalisé par Saeed Faraji et produit en 2024 en République islamique d’Iran.)