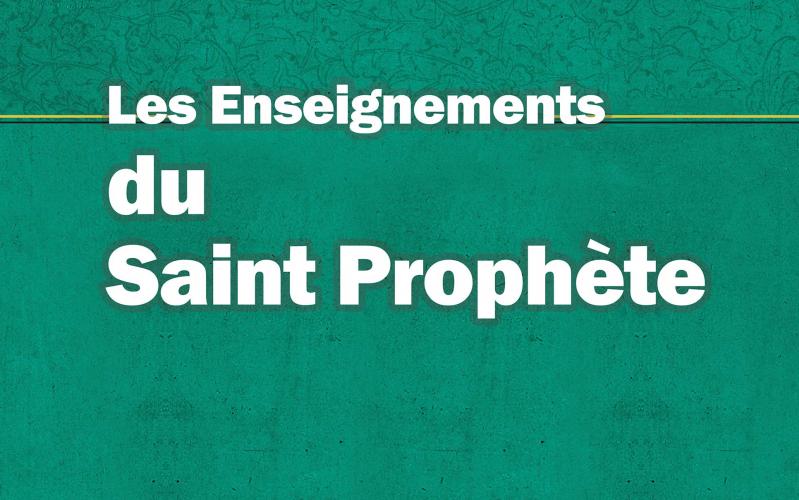« Comprendre la nature, les stratégies et les méthodes de domination de la civilisation occidentale ainsi que les moyens d’y faire face selon la pensée de l’Imam Khamenei » constitue l’un des principaux objectifs du colloque.
La conférence de presse marquant la cérémonie de clôture du colloque « Nous et l’Occident » s’est tenue le 2 novembre 2025. Cette conférence de presse, organisée à l’occasion de la Journée de la lutte contre l’impérialisme, a eu lieu à l’Institut de recherche et de culture de la Révolution islamique. La cérémonie officielle de clôture du colloque se tiendra la semaine prochaine.
Le colloque « Nous et l’Occident », qui avait débuté le 5 novembre de l’année dernière par une séance d’information, a exploré divers aspects de l’affrontement entre l’impérialisme et la Révolution islamique à travers 54 séances spécialisées, tenues à la fois en présentiel et en ligne, dans différentes villes d’Iran ainsi qu’au cours de sessions internationales organisées dans plusieurs pays.
La conférence de presse de clôture du colloque « Nous et l’Occident », inspiré des opinions et de la pensée du Guide suprême de la Révolution islamique, s’est tenue à l’Institut de recherche et de culture de la Révolution islamique en présence de Mohammad Es’haqi, adjoint à l’enseignement et à la recherche du Bureau de la préservation et de la publication des œuvres de l’Ayatollah Khamenei, de Moussa Haqqani, secrétaire scientifique du colloque, ainsi que de Moussa Najafi et Mohammad Javad Larijani, deux membres du Conseil de politique du colloque.
Mohammad Es’haqi, dans son discours, a souligné la nature de la civilisation et de la culture occidentales. Il a déclaré que les pays occidentaux sont passés du colonialisme classique à un système de domination globale, tandis que la Révolution islamique, dans le quart de siècle qui a suivi sa victoire, a réussi à créer un vaste front de résistance dont les frontières se sont même étendues à l’intérieur des États-Unis, de l’Europe, de leurs universités et de leurs centres de réflexion.
Il a poursuivi : « selon le Guide suprême de la Révolution, les fondements théoriques de la civilisation occidentale — dans des domaines tels que les droits de l’homme, la démocratie, le sécularisme et les droits des femmes — ainsi que ses fondements pratiques — la puissance militaire, économique et médiatique — sont aujourd’hui confrontés à une crise de légitimité. Les événements récents à Gaza, au Liban et dans d’autres pays montrent que l’Occident n’accorde que très peu de valeur aux droits de l’homme et à la liberté des nations.
Es’haqi a rappelé que, depuis la victoire de la Révolution islamique, ces fondements ont été remis en question plus que jamais, et il est désormais manifeste que la civilisation occidentale ne témoigne d’aucun respect réel pour les droits des nations, des femmes et des enfants.
Il a ajouté que les signes du déclin de la civilisation occidentale et de l’impasse de ses projets sont évidents dans de nombreuses régions du monde. « Leurs plans ne s’exécutent plus avec le même succès qu’auparavant et se heurtent à des échecs répétés en Asie centrale, en Amérique latine et en Asie de l’Ouest. Ces défaites sont lourdes pour une civilisation qui se considérait comme l’axe du progrès humain », a-t-il noté.
De son côté, Moussa Haqqani, secrétaire scientifique du colloque, a expliqué que l’un des objectifs fondamentaux du colloque était de comprendre la nature, les stratégies et les méthodes coloniales et dominatrices de la civilisation occidentale et du système de domination mondiale. Il a ajouté que l’éveil islamique, la reconnaissance des capacités de l’identité irano-islamique et le discours de la résistance face au système de domination constituaient également des axes essentiels de cette initiative scientifique, qui s’articule autour de douze axes principaux.
En présentant ces axes, Haqqani a déclaré : « Parmi les principaux thèmes figurent : la nature de la civilisation occidentale et les exigences nécessaires à sa compréhension ; la nature coloniale de l’Occident et son évolution historique, du colonialisme ancien au néocolonialisme ; les stratégies, les approches, les méthodes et les facteurs de la domination occidentale sur le monde ; les pays colonisateurs, leur passé colonial et les régions sous leur domination ; les révolutions anticoloniales dans le monde ; les capacités civilisationnelles de l’Iran face à la domination et au colonialisme occidentaux ; les stratégies, méthodes et moyens de domination de l’Occident, en particulier à l’égard de l’Iran ; la doctrine de la résistance et les mouvements religieux anti-impérialistes et anticoloniaux en Iran ; les personnalités iraniennes opposées à la domination et au colonialisme durant la Révolution islamique ; les fondements et les stratégies de la décolonisation et les modèles de confrontation avec le système de domination mondiale ; ainsi que la nature coloniale et impérialiste du régime sioniste et celle des États-Unis. »
Mohammad Javad Larijani, membre du Conseil de politique du colloque, a de son côté déclaré : « Les Occidentaux croient que la démocratie libérale est la meilleure forme de démocratie dans l’histoire et qu’ils ont réussi à bien gouverner leurs sociétés. Cependant, un point essentiel dans leur comportement mérite d’être souligné : les sociétés occidentales sont centrées sur la sécurité, celle-ci étant placée au-dessus de tout. »
Il a ajouté que, à titre d’exemple, avant les attentats du 11 septembre, il n’était pas permis aux États-Unis et en Europe de détenir une personne plus de 24 heures sans mandat judiciaire, et la torture était interdite par la loi — même si elle existait en pratique. Après ces événements, des lois ont été adoptées permettant la détention illimitée de suspects, et même au Royaume-Uni, certaines méthodes d’interrogatoire telles que la « noyade simulée » ont été autorisées. « La raison de ce changement, a-t-il dit, réside dans la priorité absolue donnée à la sécurité dans la pensée occidentale. »
Larijani a poursuivi : « Dans la République islamique, deux doctrines existent face à l’Occident. La première repose sur une forme d’impuissance, c’est-à-dire la croyance qu’il n’existe pas d’autre choix que de faire des concessions avec les États-Unis. Cette première doctrine se fonde aussi sur une sorte de courage inversé : penser qu’il faut renoncer à certains principes pour préserver le pays. Une troisième approche de cette doctrine consiste à accorder une confiance relative à l’Occident, estimant que malgré ses méfaits, il faut lui accorder une certaine marge de confiance. »
« La seconde doctrine, en revanche, est celle de la résistance : elle rejette toute forme d’impuissance face aux États-Unis. Nous ne sommes pas paralysés dans les domaines scientifiques, techniques et nationaux. Cette doctrine, fondée sur les enseignements de l’Imam Khomeiny et du Guide suprême, insiste sur la confiance en nos capacités internes et la préservation de la dignité et de l’indépendance nationale. Elle ne rejette pas le dialogue avec l’Occident, mais le définit dans le cadre des principes et des intérêts nationaux », a-t-il fait remarquer.
Il a conclu en déclarant que la fatwa du Guide suprême interdisant la bombe atomique illustre le fait que, dans l’école des Ahl-ul-Bayt, il n’existe pas de violence sans limite ; même en temps de guerre, la guerre menée par les musulmans n’est pas une guerre barbare, car elle reste encadrée par des règles et principes juridiques stricts.
Le colloque « Nous et l’Occident », organisé par l’Institut de recherche et de culture de la Révolution islamique en coopération avec divers centres scientifiques et universitaires, se tiendra le 10 novembre 2025 et vise à offrir une analyse critique des fondements intellectuels, du mode de vie et de la civilisation occidentale, à étudier les stratégies coloniales et impérialistes de l’Occident, et à explorer l’éveil islamique et les capacités de l’identité irano-islamique dans la confrontation avec le système de domination mondiale.
Ce colloque, inauguré le 4 novembre de l’année dernière par une séance d’information, a comporté 54 sessions spécialisées tenues en présentiel et en ligne dans plusieurs villes d’Iran ainsi que des sessions internationales dans certains pays. Dans sa section parallèle, 533 résumés d’articles ont été examinés, dont 385 ont été acceptés, et 46 entretiens scientifiques ont été réalisés avec des professeurs et des personnalités académiques de renom.
A la fin de cette session, Moussa Najafi, membre du Conseil de politique du colloque, a souligné la nécessité d’une élaboration théorique et intellectuelle claire sur la relation entre la Révolution islamique et la civilisation occidentale. Il a déclaré : « Ces dernières décennies, l’action dans la Révolution islamique a souvent précédé la réflexion théorique. Le martyr Mottahari considérait déjà que l’un des fléaux des mouvements islamiques était l’absence de plan et de vision pour l’avenir. »
Le chercheur a rappelé que la confrontation entre l’Orient et l’Occident a de profondes racines historiques — depuis les guerres entre l’Iran antique et la Grèce jusqu’à la chute d’al-Andalus — mais que le conflit moderne a véritablement commencé après la Révolution française et l’expédition de Napoléon en Égypte, lorsque l’Occident s’est considéré comme le centre du monde, reléguant les autres à sa périphérie.
Najafi a conclu : « La pensée politique de l’Imam Khamenei est une pensée civilisationnelle, fondée sur des principes. Elle n’est pas purement réactive : elle repose sur des bases claires et cohérentes avec les autres composantes intellectuelles de la Révolution islamique. Elle s’est concrétisée dans la pratique et dans la gestion du pays à différents niveaux, constituant une véritable philosophie politique appliquée. »